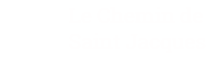Là où se trouve actuellement l’église de San Fiz de Solovio vivait l’ermite Paio
Des premiers pèlerins à l’actualité
L’ermite Paio découvre la tombe dans les années 820
C’est vers 820 qu’a lieu la découverte de la tombe de Jacques le Majeur et immédiatement la création du “locus Sancti Iacobi”, le lieu sacré pour vénérer ses restes.

À un moment imprécis des années 820-830, s’est produit la découverte de la tombe de Jacques le Majeur. Alphonse II régnait alors sur le nord-ouest de la péninsule (Royaume d’Asturias). C’est lui le premier grand protecteur. Il avait été élevé au Monastère de Samos et a reçu avec joie la nouvelle que lui a transmise l’évêque d’Iria, Teodomiro.
L’ermite Paio avait remarqué pendant plusieurs nuits des lumières énigmatiques au dessus de la forêt de Libredón et en a informé l’évêque Teodomiro de Iria
Un ermite du lieu de Solovio (où se dresse aujourd’hui l’église de San Fiz de Solovio), dénommé Paio, a localisé dans la forêt de Libredón, les restes d’un enterrement primitif. Il contient celles qui seraient identifiées comme les tombes de l’apôtre Jacques et de ses disciples, Théodore et Athanase.
Cette apparition confirme une tradition populaire enracinée, documentée auparavant par les moines Beda le Vénérable et Béat de Liébana. Mais il manquait ces preuves. Rapidement, le roi Alphonse II a visité les lieux et fait construire une église modeste, reconstruite par la suite par Alphonse III (année 899). C’est le germe de l’actuelle cathédrale et de la ville de Saint Jacques.
Des rois, des abbés et des moines, les premiers pèlerins (IXe et Xe siècles)
Des rois d’Asturias, des abbés et des moines français et allemands ont été les premiers à venir à Saint Jacques, dès la fin du IXe siècle.

Les souverains d’Asturias Alphonse II et Alphonse III, avec la cour d’Oviedo, ont été les premiers pèlerins connus du IXe siècle. Alphonse III le Grand a fait le pèlerinage en 872, puis il est retourné avec la reine Chimène deux ans plus tard, en 874, donnant à l’apôtre une croix en or et pierres précieuses, symbole du Royaume d’Asturias.
Les rois d’Asturias Alphonse II et Alphonse III, avec la cour d’Oviedo, sont les premiers pèlerins connus du IXe siècle
Au Xe siècle commencent à arriver des pèlerins européens, comme Bretenaldo, en 930, un franc qui a décidé de s’installer dans la primitive Compostelle. Deux ans plus tard, vers 932, le roi Ramiro II a fait le pèlerinage. Toutefois, le pèlerin le plus célèbre du Xe siècle a été l’évêque Gotescalco de Le Puy, qui a voyagé à Compostelle en compagnie d’autres prêtres et d’un groupe de fidèles d’Aquitaine, à la fin de l’année 950.
Peu après, en 959, l’abbé Cesáreo, du monastère catalan de Sainte Cécile de Monsterrat a fait le pèlerinage au lieu saint. Il a demandé l’aide de l’église compostellane pour solliciter au pape la restauration du siège épiscopal de Tarragone. Cette démarche d’intercession a augmenté l’influence du siège apostolique dans le royaume de León, renforçant la position de Compostelle comme siège prestigieux de l’ouest de la péninsule.
L’âge d’or des pèlerinages (XIe-XIIIe siècles)
De France, d’Italie, du centre et de l’est de l’Europe, d’Angleterre, d’Allemagne, voire d’Islande et, bien entendu, de toute l’Hispanie, les pèlerins arrivaient à pied, à cheval, en bateau…

Saint Jacques s’est rapidement consolidée comme centre de pèlerinage international entre le XIe et le XIIIe siècle. Grâce à une union de forces et d’intérêts menée, à faveur de Compostelle, par les principaux centres de pouvoir occidental : la couronne (d’Alphonse II à Alphonse III et à Sancho Ramírez), la papauté (Calixte II et Alexandre III) et les ordres monacaux (les abbayes de Cluny et de Cîteaux). C’est ainsi que le Chemin a écrit son histoire millénaire.
L’histoire nous parle aussi du pèlerinage à la tombe de l’apôtre, en 1214, de Saint François d’Assise
L’âge d’or des pèlerinages se situe à cette époque : de France, d’Italie, du centre et de l’est de l’Europe, d’Angleterre, d’Allemagne, voire d’Islande. Et, bien entendu, de toute l’Hispanie. Les pèlerins arrivaient à pied, à cheval, en bateau… et étaient assistés principalement par un réseau d’hôpitaux fondés par des rois, des nobles et des bourgeois des villes, surtout dans les quartiers de francs, et par les moines de Cluny, qui recevaient les pèlerins dans leurs monastères.
L’histoire nous parle aussi du pèlerinage à la tombe de l’apôtre, en 1214, de Saint François d’Assise, fait qui inaugure un des chapitres les plus fertiles du Chemin de Saint Jacques : la rénovation de la spiritualité occidentale à travers le travail éducatif, évangélisateur et fraternel des franciscains. À Saint Jacques, ils ont fondé le premier couvent de l’ordre.
L’hospitalité, signe d’identité du Chemin de Saint Jacques
L’accueil des pèlerins constitue un des aspects fondamentaux de l’expérience du Chemin depuis le Moyen Âge.

L’accueil des pèlerins constitue un des aspects fondamentaux de l’expérience du Chemin depuis le Moyen Âge. Un service permanent d’assistance médicale et spirituelle qui a été organisé par les différentes institutions, de la Couronne et l’Église au peuple lui-même. La fondation d’hôpitaux dédiés à assister les besoins spirituels, matériels et de santé du nombre croissant de pèlerins qui se dirigeaient à Saint Jacques a été cruciale.
Dès les premiers temps du pèlerinage, la Couronne, l’Église et le peuple ont organisé un service permanent d’aide médicale et spirituelle
La plupart des institutions hospitalières pour pèlerins et pauvres ont été créées à l’aide de donations de communautés religieuses, des sièges épiscopaux, des familles nobles, le haut clergé et, surtout, par les rois. Ces derniers ont fait bâtir un grand nombre d’hôpitaux sur le Chemin de pèlerinage, faisant part ainsi de la volonté de la Couronne d’exercer la vertu chrétienne de la charité et de servir Dieu et Saint Jacques, le saint patron du royaume. Dans les petits hôpitaux médiévaux il était habituel d’avoir des salles avec douze lits ou six lits à deux places, en souvenir des douze apôtres de Jésus.
Pour la mentalité médiévale, le pèlerin était un envoyé du Ciel, c’est pourquoi il fallait le considérer et le traiter comme s’il s’agissait de Jésus Christ lui-même. Il n’était donc pas rare que sur les scènes de l’apparition de Jésus ressuscité aux disciples d’Emmaüs, le Sauveur ait été représenté comme un pèlerin, avec des distinctifs propres au pèlerinage jacobée tels que la gibecière et la coquille saint jacques. La représentation la plus connue de cette image est un relief roman dans le cloître de Santo Domingo de Silos (Burgos).
Le bas Moyen Âge (XIVe et XVe siècles)
Le Chemin a résisté à cette époque les périodes prolongées de famine, de crise économique et de pensée.

L’histoire du Chemin de Saint Jacques se déroule parallèlement aux vicissitudes de l’histoire de l’Europe. Mais malgré l’influence négative sur la vie et la culture d’épisodes comme la « Guerre de Cent Ans » (1337-1453), la Peste Noire (1348) et les périodes prolongées de famine et de crise économique et de pensée, le Chemin de Saint Jacques s’est maintenu vivant tout au long du XIVe siècle, malgré les difficultés, et du XVe siècle, plus bénévole.
À la fin du XIVe siècle, la Galice côtière – avec le port d’A Coruña comme référence – renforcera avec l’Europe atlantique un dynamisme commercial ayant d’excellents résultats
Lors de la célébration de l’année sainte romaine de 1300, le pape a donné aux pèlerins l’Indulgence Pleine ou pardon des pêchés. À la fin du XIVe siècle a commencé une étape d’essor économique, qui s’est poursuivie au siècle suivant. Dans ce cadre de crise, de chaos et de reprise, les paysans, les bourgeois, les guerriers, les nobles et les religieux faisaient le pèlerinage surtout pendant les périodes de trêve, sous couvert d’une vision du cosmos qui interprétait la Voie Lactée comme un chemin pour les âmes à destination du Paradis.
La rencontre avec le merveilleux séduisait tant les plus humbles que les chevaliers. Le roi Alphonse XI de Castille (1325-1350) a été fait chevalier à Compostelle. Isabelle d’Aragon (ca. 1270-1336), veuve du roi Dinís de Portugal, a réalisé le pèlerinage en 1325, et a donné sa couronne, entre autres possessions et richesses personnelles. Au début de 1343 est arrivée à Compostelle Sainte Brigitte de Suède (1303-1373), qui a fait le pèlerinage accompagnée de son mari, Ulf Gudmarsson, et d’autres personnes. Dans la cathédrale, elle a eu une vision mystique, quelque chose d’habituel dans sa vie.
Pendant le dernier tiers du XIVe siècle, la Galice côtière renforcera avec l’Europe atlantique un dynamisme commercial ayant d’excellents résultats. La situation de crise soufferte en France, en Flandre, en Angleterre et dans d’autres pays, a favorisé en Galice un commerce international associé au pèlerinage par la voie maritime, qui trouvera à A Coruña, port de pèlerins, son principal lieu de référence.
Au port d’A Coruña sont arrivés, pendant les dernières décennies du XIVe siècle et pendant tout le XVe, un grand nombre de bateaux chargés de pèlerins de Flandre, de Bretagne, d’Angleterre et des pays de la Baltique, ainsi que des marchandises de Flandre, d’Andalousie, de Catalogne, de Gênes et de Venise. Ces mêmes quais exportaient du poisson fumé vers la Méditerranée et du vin de Ribeiro à destination de l’Europe atlantique.
Le pèlerinage jacobée à l’Époque Moderne (XVIe-XVIIIe siècles)
La Réforme protestante et les guerres de religion sur les territoires allemands et en France ont fortement réduit le nombre de pèlerins sur le Chemin.

Au XVIe siècle, le Chemin de Saint Jacques a vécu une crise profonde, causée par diverses raisons. En premier lieu, la sensibilité des intellectuels humanistes a eu une influence négative. Ceux-ci partaient de la critique ironique qu’Érasme de Rotterdam a dédié au sujet du pèlerinage. Une critique qui s’est durcie avec Luther. La Réforme protestante et les guerres de religion sur les territoires allemands et en France ont fortement réduit le nombre de pèlerins sur le Chemin. Avec la guerre ouverte entre l’Espagne impériale de Charles V et la France, cette situation de rupture s’est maintenue, et a encore empiré du temps de Philippe II, avec la fermeture de frontières pour éviter l’entrée du luthéranisme dans ses royaumes.
En mai 1589, craignant une attaque à Compostelle des anglais de Francis Drake, dont les bateaux attaquaient A Coruña, l’archevêque Juan de Sanclemente a fait cacher le corps de l’apôtre
L’Inquisition a également constitué un problème au XVIe siècle, car ses soupçons visaient tous les étrangers, voire les pèlerins jacobées, dont certains étaient accusés d’espionnage. Après le Concile de Trente (1545-1563), l’église catholique s’est réarmée idéologiquement, avec l’exaltation du culte à la Vierge et aux saints.
En mai 1589, craignant une attaque à Compostelle des anglais de Francis Drake, dont les bateaux attaquaient A Coruña, l’archevêque Juan de Sanclemente a fait cacher le corps de l’apôtre dans l’enceinte du presbytérium de la cathédrale. L’endroit où il se trouvait a été ignoré pendant plusieurs siècles, jusqu’à 1879, année de la deuxième découverte des restes de l’apôtre.
La religiosité baroque, imbibée de cet esprit de contre-réforme, a favorisé la réactivation du Chemin de Saint Jacques au XVIIe siècle, en particulier pendant les années saintes. Bien que sur la route devront cohabiter les jacobites et les faux pèlerins, dont l’intérêt consistait à vivre de la charité et de l’aumône dans les villes. La Révolution Française de 1789 et la guerre déclarée par plusieurs puissances européennes contre la France donneront lieu à une nouvelle baisse du nombre de pèlerins à la fin du XVIIIe siècle.
Le Chemin de Saint-Jacques à l'époque contemporaine (XIXe et XXe siècles)
La deuxième découverte des reliques de l’apôtre (1879) a marqué la reprise d’un Chemin qui, par la suite, au XXe siècle, allait être conditionné par le fléau de la Guerre d’Espagne et les Guerres Mondiales.

Espagnols et portugais ont maintenu la flamme du pèlerinage, pendant des décennies manquant d’affluence. Manque qui a même affecté les années saintes. La tendance à commencé à changer à partir de la deuxième découverte du corps de Saint Jacques en 1879, avec la déclaration papale de la découverte des restes de l’apôtre, affirmée dans la bulle Deus Omnipotens (1884), et avec la célébration d’une année sainte exceptionnelle en 1885.
Pendant les années 1950 et 1960 la reprise a commencé timidement, avec la création des premières associations jacobées de Paris (1950) et d’Estella (1063), et la célébration des années saintes 1965 et 1971
Le Chemin de Saint Jacques a connu un nouvel essor vers la fin du siècle et au début du XXe, surtout grâce à l’action pastorale des archevêques Payá et Martín de Herrera. Le désastre de la Guerre Civile Espagnole (1936-1939) a divisé en deux une société qui allait tarder à récupérer l’élan des pèlerinages, dans une Europe plongée dans deux guerres mondiales et la tension ultérieur de la « guerre froide ».
Pendant les années 1950 et 1960 la reprise a commencé timidement, avec la création des premières associations jacobées de Paris (1950) et d’Estella (1063), et la célébration des années saintes 1965 et 1971. L’élan définitif allait arriver à partir de 1982, avec le pèlerinage du pape Jean-Paul II et son discours européiste devant le maître autel de la cathédrale de Saint Jacques.
Dans l’actualité
Face à un monde globalisé, l’expérience du pèlerinage à Saint Jacques est unique.

Les premières décennies du XXIe siècle sont marquées par une conception globale de la pensée et de l’économie, le développement de la technologie numérique au service de la communication, la culture et les loisirs, la menace du terrorisme jihadiste – les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington peuvent marquer le début du siècle –, un souci croissant pour l’environnement et le début, en 2008, d’une crise économique mondiale qui a durci la situation sociale.
Dans ce début de siècle et de millénaire, le pèlerinage jacobée est plus que jamais un phénomène transversal : d’une part, spirituel et œcuménique, également ouvert à la connaissance, à l’amitié et à la compréhension mutuelle.
Face à cette anxiété et cette recherche de nouvelles expériences enrichissantes, le pèlerinage traditionnel à Saint Jacques propose un changement radical de comportement, une alternative de valeurs humaines et universelles face à un monde de plus en plus globalisé, mais aussi aliénant et compétitif.
Dans ce début de siècle et de millénaire, le pèlerinage jacobée est plus que jamais un phénomène transversal : d’une part, spirituel et œcuménique, également ouvert à la connaissance, à l’amitié et à la compréhension mutuelle. Un Chemin où les pèlerins comptent l’expérience des paysages, de l’histoire, de la culture partagée et de la solidarité.
Le pèlerin se trouve de nos jours face à un espace considéré sacré pendant des siècles : le Chemin de Saint Jacques ; une géographie sacralisée qui est aussi itinéraire historique et culturel. C’est en définitive une manière différente de pèlerinage, qui ne rejette pas la manière traditionnelle, mais qui lui a ajouté les aspirations et les motivations des sociétés contemporaines.